Les fantômes de la forme — Margiela, Raf, Owens et The Row, ou l’esthétique de l’archive
- AMPM
- 23 mai 2025
- 4 min de lecture
Cinq maisons, cinq gestes pour habiter la mémoire

Le vêtement n’habille plus : il convoque. Chez Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Dries Van Noten ou The Row, il devient un lieu de mémoire. Un territoire où l’archive n’est pas un vestige figé, mais une matière vivante — spectrale, parfois blessée, toujours signifiante.
Dans ces cinq maisons, l’histoire ne s’affiche pas : elle se glisse. Elle se plie, se déforme, se répète. Le vêtement agit comme une surface hantée, où chaque volume porte en lui les empreintes d’un avant.
Margiela — Le vêtement comme relique trouée
Chez Margiela, le vêtement est un fragment, une structure exposée, une couture retournée. Rien ne cache son origine — tout est trace.
Fondée en 1988 par Martin Margiela, la maison a toujours cultivé l’anonymat comme méthode. Aujourd’hui encore, sans direction artistique visible, elle fonctionne comme un atelier fantôme. L’archive y est matérielle, brute, presque blessée. Margiela prélève dans le réel des éléments obsolètes : gants de cuir anciens, cravates démodées, jupes d’écolière. Il les démonte, les découd, les recompose — comme dans ces robes formées de foulards vintage (printemps-été 1999), ou ces gilets construits avec des gants repliés (Artisanal 2006).
Il n’y a pas de glorification du passé. Margiela ne commémore rien. Il exhume, il dérange, il réanime. Ses vêtements flottent entre les âges, comme des artefacts textiles à peine restaurés. Dans cette incomplétude réside l’élégance : celle d’un geste qui préfère le fragment à la forme pleine, l’écho à l’affirmation.
Raf Simons — Le vêtement comme manifeste adolescent
Chez Raf Simons, le souvenir est affectif, nerveux, saturé d’images. Le vêtement devient un collage de références culturelles, de cris visuels, de fictions adolescentes.
Créateur de sa propre maison depuis 1995 et aujourd’hui codirecteur artistique de Prada, Raf Simons construit ses collections comme des albums d’archives intimes. La série “Riot Riot Riot” (2001), les pulls imprimés de Peter Saville (2003), la collaboration permanente avec l’artiste Sterling Ruby, en sont des preuves. Il imprime, sur des matières brutes, les signes d’une époque : slogans, collages, portraits d’adolescents — tous arrachés à la mémoire collective.
Simons n’idéalise rien. Il tend des fils entre passé et présent, il exacerbe les tensions. Sa mode ne reconstitue pas, elle rejoue. Elle cite la jeunesse comme on évoque une blessure. Chaque pièce est une page arrachée à un carnet d’obsessions : le vêtement devient archive en devenir, mémoire mobile, émotion stratifiée.
Rick Owens — Le vêtement comme sculpture rituelle
Chez Rick Owens, le vêtement est une forme archéologique, comme taillée dans un sol ancien. Il ne cite pas, il invoque.
Depuis 1994, Rick Owens développe une esthétique rigoureuse, obsessionnelle, presque cérémonielle. Les drapés romains, les silhouettes gothiques, les vestiges médiévaux sont présents, mais toujours détournés. Les vestes en cuir rappellent les armures ; les jupes longues, les tenues sacerdotales. Il répète ses formes comme des rituels : épaules projetées, hanches effacées, volumes allongés.
Rick Owens ne parle pas du passé — il parle de survivance. Ses vêtements semblent échapper au temps, comme s’ils sortaient d’un sol encore fumant. L’archive est dans les plis, dans la matière, dans la manière dont le vêtement transforme le corps en sculpture. Une mémoire fossile, mais toujours palpitante.
Dries Van Noten — Le vêtement comme récit textile
Chez Dries Van Noten, la mémoire est visuelle, sensible, cosmopolite. Elle prend la forme d’un motif, d’une broderie, d’un imprimé qui raconte.
Depuis les années 80, Dries compose ses collections comme des récits. Il puise dans des archives textiles, des catalogues anciens, des photographies botaniques, des vêtements rituels oubliés. Sa collection automne-hiver 2005, inspirée du Victoria & Albert Museum, ou celle de l’été 2018, hommage aux arts asiatiques, en témoignent. Il assemble sans hiérarchie : pantalon militaire, blouse de soie, manteau tissé comme un tapis afghan.
Chez Dries, le vêtement ne documente pas une époque — il fait dialoguer les fragments. Il ne classe pas la mémoire : il la réorganise, la laisse respirer. L’archive est ici un alphabet généreux, offert sans dogme, sans drame. Une douceur intelligente.
The Row — Le vêtement comme silence habité
Chez The Row, le vêtement ne cite pas. Il se souvient en creux. Il s’inscrit dans la ligne, se prolonge dans le geste, s’efface dans le silence.
Fondée en 2006 par Mary-Kate et Ashley Olsen, The Row a construit une esthétique de la retenue : rigueur, équilibre, effacement. Ici, la mémoire s’absorbe dans la coupe, dans la précision du tombé, dans le poids d’un beige à peine formulé. On devine Carolyn Bessette, Calvin Klein, Geoffrey Beene — mais sans jamais voir leurs visages.
Ce n’est pas un travail de citation. C’est une mémoire distillée. Le vêtement devient une surface lisse, mais chargée. Il condense des souvenirs sans les nommer. L’élégance naît de ce refus d’effet, de cette précision invisible. The Row travaille le passé comme on affine un parfum : jusqu’à ce qu’il n’en reste que la trace.
Une archive à cinq voix
Revenir aux mêmes formes, aux mêmes obsessions, n’est pas un repli. Chez ces cinq maisons, la répétition est un outil. Le passé n’est pas ici récit, mais matière. Une surface à façonner.
• Margiela découd le passé, le rend visible, brut.
• Raf Simons le crie, le colle, le rejoue.
• Rick Owens l’enterre dans le corps, le sublime.
• Dries Van Noten le brode, le compose, l’accueille.
• The Row l’efface avec grâce, sans jamais le nier.
Cinq gestes. Cinq façons d’habiter le temps.
Et au centre : le vêtement, posé comme un palimpseste.
Une page vivante, où chaque couture laisse trace.
Crédits : Vogue Magazine, The Row, Dries Van Noten, Rick Owens, RAF Simons, Margiela





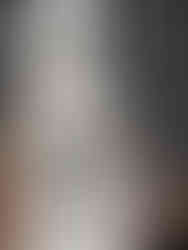


























































Commentaires